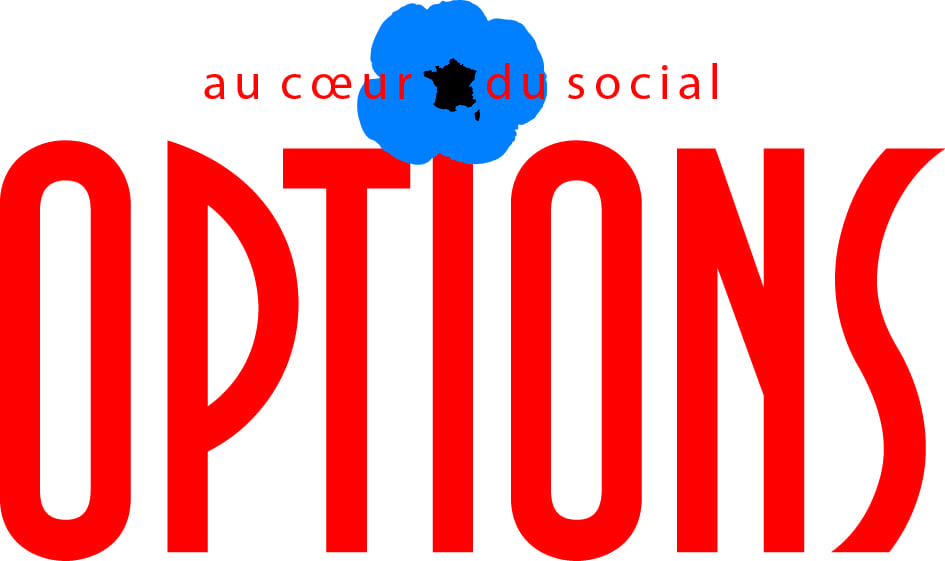Faites ce que je vous dis, pas ce que je… L’expression « se prendre les pieds dans le tapis » signifie que « les choses ne se déroulent pas tou- jours comme on le souhaiterait ». Pour dépas- ser le caractère trop général de cette définition, le dictionnaire en précise le sens, à l’aide d’un […]
Faites ce que je vous dis, pas ce que je…
L’expression « se prendre les pieds dans le tapis » signifie que « les choses ne se déroulent pas tou- jours comme on le souhaiterait ». Pour dépas- ser le caractère trop général de cette définition, le dictionnaire en précise le sens, à l’aide d’un développement laborieux mais explicite : « elle s’applique notamment lorsqu’on se trompe dans la réalisation d’une tâche compliquée ou que l’on fait face à des difficultés pour accomplir quelque chose». À l’aune de cette précision, Emmanuel Macron est champion, toutes catégories, des pieds pris dans le tapis. D’ailleurs ce n’est plus un tapis ; c’est un foutoir, une géographie dispersée façon puzzle, un amas hétéroclite de bosses, de plis, de vagues roulantes et de sables mouvants. La fin de l’année 2020 confirme à cet égard, et avec éclat, que (en) marche n’est pas sens. À propos… Bonne année 2021 à toutes et à tous. Cela devait être dit, c’est fait, revenons à nos… Macron. Sa contamination au Covid aura confirmé que l’homme s’autorise à faire ce qu’il interdit et déconseille aux autres, avec toute l’autorité du premier magistrat du pays : dîners successifs prolongés après le couvre-feu imposé au pays et nombre de couverts supérieur à ce maximum de six fixé… aux gens du commun.
L’anecdote en dit long sur l’éthique aristocra- tique en vogue dans les salons élyséens et sur la méthode avec laquelle on mène les affaires publiques. Le « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais » se décline en effet en engagements pouvant se résumer à un solennel « faisons-nous confiance, j’improviserai les suites ». Le « je » présidentiel n’a d’ailleurs jamais été aussi central dans la vie politique française, qui en a pourtant connu d’autres. Mais cet affichage n’est que pos- ture et fragilité. Ces derniers mois, il s’est fracassé spectaculairement sur les institutions, l’adver-
sité, bref, sur le réel, qui déteste qu’on le snobe. De Beyrouth à Beauvau, de la loi sur la sécurité globale à celle sur les principes républicains, Emmanuel Macron a adopté la même mise en scène : promesse, mise en débat et, finalement, mise de côté. Cela commence par un sourire écla- tant de compréhension inclusive et chute sur les gros yeux faits aux galopins qui rigolent de le voir s’embrouiller les pieds dans sa trame tapissière.
D’accord ? Pas d’accord ? Alors attendons un référendum
La convention citoyenne sur le climat, par exemple. L’idée de départ – demander aux citoyens s’ils n’auraient pas des idées sur la ques- tion – est excellente. Le président s’y engage, tranquille et prêt à jurer, mordicus, qu’ils n’en ont aucune. La chose se complique donc rapide- ment, car ils en ont. Or, on leur a promis, main sur le cœur qu’elles auront, sans filtre, force de loi. Problème : en marche ou à l’arrêt – ce qui ici revient au même –, aucun député n’aime qu’on lui détricote le tapis légal sous ses pieds. Aux prises avec des gens qui, d’un côté comme de l’autre, sont très en colère, le président sort un joker : un référendum pour inscrire la question climatique dans l’article 1 de la Constitution. L’opération, aux relents lourdement manipulateurs, renvoie tout à – beaucoup – plus tard, n’offre aucune certitude de pouvoir se faire et, en admettant qu’elle parvienne à ses fins, ne ralen- tira pas d’un degré le réchauffement climatique. Ravi de la manœuvre, Emmanuel Macron la res- sert, telle quelle, à la police. On sait, depuis que l’Élysée l’a répété sur tous les tons, que les vio-ences policières sont une légende urbaine. Il a
d’ailleurs préparé une loi interdisant de la fil- mer. Mais voilà qu’une vidéo hardcore atteste du mythe ; le président rétropédale et invente une vague commission chargée de modifier son projet de loi, pour le coup trop sulfureux. À nouveau, tempête à l’Assemblée, tsunami au Sénat, vagues de rage dans l’opinion publique. Pris de tournis, le président déclare alors d’une voix chaleureuse et sincère devant le jeune public de Brut, que les jusqu’alors inexistantes violences policières sont inadmissibles. Se fait-il quelques copains dans la jeunesse ? Peut-être… En revanche, son ministre s’étrangle de rage tandis que ses policiers menacent le pays de leur fatale clé d’immobilisa- tion. Nouveau claquement de doigts, chapeau : faisons un grand Beauvau de la police – tous ensemble, tous ensemble – pour débattre des problèmes ! Débattre ? Échaudés sans doute, et de surcroît peu rompus à l’exercice, les policiers déclinent. Sèchement. La salle se vide, les illusions s’évanouissent, reste l’illusionniste.
L’impensé technocratique bégaye à la barre
Mais le spectacle continue. C’est d’ailleurs le grand paradoxe et l’un des grands dangers de la période. Dans un régime dont la Constitution garantit de jure des mécanismes institutionnels qui struc- turent des mécanismes de décision démocratique, l’exercice réel du pouvoir se déploie dans le déni hautain des corps intermédiaires. Sans épargner aucunement ceux dont le soutien lui est assuré. Le mépris du débat institutionnalisé, de celles et ceux qui le portent, des organisations et associations qui l’incarnent a pu, un temps, relever d’une stratégie, d’un calcul. Aujourd’hui, c’est devenu une culture, un réflexe, la victoire d’un impensé technocratique sur les complexités démocratiques. Lesquelles, mises à la porte, se font un malin plaisir à revenir par les fenêtres, envahissant ainsi l’espace du débat public de leur légitimité refoulée, voire d’un magma de simples refus. C’est littéralement compulsif : on sème la défiance face à une pandémie, on provoque les hurlements de ceux qu’on tente de bâillonner, on provoque le désordre en uniforme en lieu et place d’une urgente civilité.
Pris dans ce bégaiement à la Gribouille, le président ramène de plus en plus toute chose à sa personne, fait flèche de tout bois et s’agrippe à des projets de loi liberticides. Comme cela passe mal, il s’essaie à la diversion ; fait mine de découvrir l’inceste et… crée une commission ; rajoute à ses « principes républicains »… l’interdiction des thérapies de conversion, soulevant au passage l’ire de l’Inter-Lgbt, légitimement inquiète de ce micmac hâtivement bricolé.
Nous écrivons ces lignes avant que 2021 ne commence, sans avoir encore connaissance des traditionnels vœux présidentiels. Soyons certains que 2021 apportera son lot de sursauts. Les vœux d’Emmanuel Macron, eux, seront sans surprise.
Pierre TARTAKOWSKY