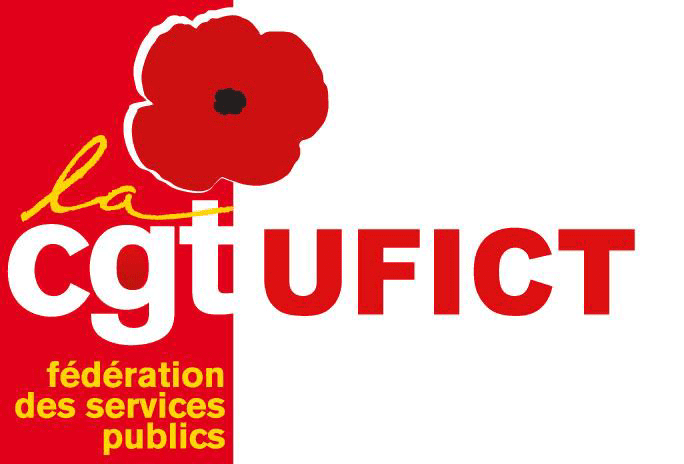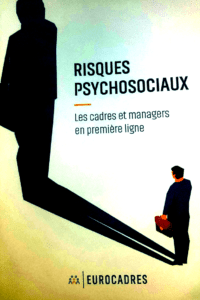Perte de sens, conditions dégradées… La France confrontée à la grande rotation des salariés.
Enquête
Le manque de bras dans des secteurs entiers de l’économie traduit une nouvelle relation au travail, mûrie durant la crise sanitaire. Pour des raisons qui touchent moins aux salaires qu’au sens qu’ils attribuent à leur emploi, des actifs décident de changer de travail dans l’espoir d’un nouvel équilibre.
- Antoine Oberdorff, le 11/08/2022 à 06:58
Lecture en 4 min.
Vers la version PDF : ici

182 290 postes à pourvoir dans les services à la personne, 143 860 dans le commerce et la grande distribution, 139 370 dans l’hôtellerie-restauration, presque autant dans l’industrie, le bâtiment, les transports… Au premier trimestre 2022, plus d’un million d’offres d’emploi étaient ainsi recensées par Pôle emploi, contre un stock tournant habituellement autour de 700 000.
Au-delà de l’écart classique dû à l’inadéquation entre l’offre d’emploi, la demande et les qualifications, ces chiffres donnent le vertige aux employeurs et interrogent : où sont passés les salariés ?
À lire aussi Chômage : la baisse continue mais son rythme ralentit
S’il est périlleux de retrouver la trace des salariés qui manquent à l’appel dans ces secteurs, une chose est sûre : ces individus ne se sont pas retirés du marché du travail puisque le taux d’emploi des 15-64 ans est à son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure. Impossible, donc, de parler en France de « grande démission », comme celle que connaissent les États-Unis, où un tiers de la population active totale a quitté son emploi en 2021, soit 48 millions d’Américains. Les observateurs préfèrent le terme de « grande rotation » pour caractériser les 470 000 personnes qui ont quitté leur CDI au premier trimestre 2022, selon la Dares, le service des statistiques du ministère du Travail.
« La difficulté de la situation actuelle est liée à la multiplicité des facteurs à l’origine de cette tension sur le marché de l’emploi », rapporte Franck Ribuot, président du Groupe Randstad France, leader mondial de l’intérim. Il évoque notamment l’explosion de l’apprentissage, qui concerne désormais 800 000 jeunes moins susceptibles d’occuper des emplois saisonniers ou le soir et le week-end, les départs anticipés à la retraite, mais aussi « des ruptures conventionnelles qui donnent lieu à des périodes de réflexion, de formation, voire de reconversion ».
Des conditions de travail moins bien vécues
La rupture conventionnelle, Wendy Serrat y a eu recours fin 2019, après avoir travaillé six ans en tant qu’agente de nettoyage sur les avions de ligne à l’aéroport de Marseille-Provence. « Des horaires décalés, des astreintes le week-end et les jours fériés, la situation était devenue invivable », souffle la jeune maman. « Les heures supplémentaires ne nous étaient jamais payées : les managers compensaient en nous donnant quelques heures de repos à l’aéroport entre deux vols. Mon salaire servait uniquement à payer l’assistante maternelle », se souvient celle qui occupe désormais un poste d’assistante administrative dans une entreprise de chimie, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Elle ne gagne pas mieux sa vie qu’auparavant, mais profite des week-ends avec sa fille et des avantages d’un comité d’entreprise, ainsi que de primes trimestrielles.
À lire aussi Quand le travail perd son sens
Son cas est loin d’être isolé. Christine Ehrel, directrice du Centre d’études de l’emploi et du travail au sein du Cnam, souligne « les problèmes d’attractivité de certains secteurs tels que l’hôtellerie-restauration, l’entretien et le nettoyage et le médico-social, qui offrent des conditions de travail trop difficiles pour des salaires trop faibles ». Les horaires atypiques ou imprévisibles, les temps d’attente non rémunérés… Autant de contraintes qui empiètent sur la vie personnelle et sont « d’autant moins bien tolérées que les salariés n’entrevoient aucune perspective de carrière », précise l’économiste, coautrice d’un rapport sur la reconnaissance et la revalorisation des métiers dits de « deuxième ligne » (caissiers, agents d’entretien, aides à domicile, etc.).
Un manque de perspectives de carrière
« Aujourd’hui, la reconnaissance est au moins autant une question de “pouvoir d’agir” des salariés dans leur travail que d’argent. Ils ne veulent plus être traités comme des pions, ils aspirent à développer leurs compétences, y compris dans des métiers a priori peu qualifiés », abonde son collègue Thomas Coutrot, ancien chef du département « conditions de travail et santé » de la Dares et coauteur de Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire.
À lire aussi Être heureux au travail, idéal ou illusion ?
Un rétrécissement des perspectives qu’a subi Raphaël Bach au cours de dix années passées dans la grande distribution discount à Toulouse : « Lorsque je suis arrivé, à l’issue de mon BTS, nous avions des primes pour aller chercher des objectifs. Les gens restaient longtemps dans l’entreprise, ce qui permettait de connaître tout le monde. » Promu directeur de magasin, il a eu le sentiment de devenir « un porte-clés avec des horaires d’ouverture 7 jours sur 7 ». « Malgré mon savoir-faire et mon statut de directeur, on me faisait sentir que j’étais interchangeable. À la longue, ma seule ligne d’horizon était devenue ma fiche de paie », raconte le quadragénaire, qui s’est lancé dans une nouvelle aventure à l’issue de la crise sanitaire : la viticulture, sur un domaine familial dans le Lot.
Redonner du sens au travail
La perte de sens au travail est sans doute l’une des variables qui jouent le plus sur le taux de démission, à en croire l’économiste Thomas Coutrot : « Il s’agit, pour les salariés, de pouvoir déployer leur énergie sans être entravés par une organisation trop rigide, des objectifs chiffrés, des procédures à n’en plus finir. »
À lire aussi « On travaille continuellement en mode dégradé » : urgences, un été sous tension
Une crise de sens qui survient de plus en plus tôt, par exemple chez les infirmières : 30 % d’entre elles quittent la profession dans les cinq ans suivant leur diplôme, selon le Syndicat national des professionnels infirmiers. À 22 ans, Anniela Garon a renoncé, après quatre années d’études, de peur d’être «cette infirmière en burn-out qui se serait épuisée à vouloir colmater les brèches d’un système de santé exsangue ». Les revalorisations salariales permises par le Ségur de la santé ne l’ont pas dissuadée de quitter le secteur hospitalier.
À lire aussi Burn-out : les infirmiers, kinés, orthophonistes aussi touchés
La jeune femme a consigné les raisons de son choix dans une lettre : « Dès l’entrée dans les études, c’est la précarité que nous côtoyons avec des indemnités de stage faibles et tardives. Dès le commencement, nous sommes dans le faux, dans le manque de considération, dans l’impossibilité de véritablement soigner et prendre soin. » Dans l’espoir de « retrouver une utilité », Anniela envisage de s’orienter vers la solidarité associative à la rentrée prochaine.
À défaut de faire émerger le « monde d’après », les lendemains de la crise sanitaire augurent ainsi une nouvelle relation au travail dans laquelle la démission est redevenue une option pour des salariés en souffrance, dans un marché du travail dynamique et où le rapport de force se rééquilibre entre employeur et salarié. Les embauches en CDI ont progressé de 18,5 % au premier trimestre 2022 par rapport au niveau d’avant-crise.
À découvrir Le plein-emploi évoqué par Emmanuel Macron : une promesse réaliste ?